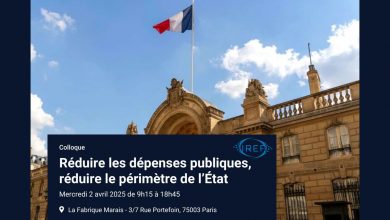Y a-t-il des gagnants au protectionnisme?
La guerre commerciale sera moins lourde à supporter pour les Etats-Unis que pour leurs partenaires. La meilleure parade pour l’Europe reste de se réformer et de renforcer ses échanges avec le reste du monde. Texte d’opinion par Cécile Philippe, présidente de l’Institut économique Molinari, publié dans Les Échos.
L’administration Trump affirme son attrait pour les droits de douane, qui à l’entendre seraient une solution gagnante pour l’Amérique. Nombre de commentateurs jugent à l’inverse que le protectionnisme ne fait que des perdants. Les deux positions passent à côté d’un point important : depuis Adam Smith, les économistes expliquent que les droits de douane existent car ils génèrent des gains significatifs pour des minorités agissantes. Leur disparition est souvent plus difficile à obtenir car les perdants sont disséminés et ont du mal à faire prévaloir leurs intérêts. Le protectionnisme, politique globalement néfaste pour la société, est donc facile à mettre en place et difficile à remettre en cause.
Du point de vue américain, la question tarifaire est sans doute moins cruciale qu’elle ne l’est pour d’autres zones du monde car leur économie est moins globalisée qu’on ne le croit. Ainsi, les importations de biens et services ne représentaient que 14 % du PIB et n’ont pas bougé, soit un niveau inférieur à la Chine (18 % du PIB) et à l’UE (22 %). Côté exportations, l’ouverture est aussi limitée avec des ventes représentant 11 % du PIB, là aussi proportionnellement moins que la Chine (20 %) et a fortiori l’Union européenne (23 %).
Dévastateur pour les secteurs en déclin
Le coût économique pour les Etats-Unis sera donc limité, même s’il est dévastateur pour des secteurs en déclin comme celui de l’automobile, dont les prix de production dépendent étroitement des échanges avec le Mexique et le Canada. A l’opposé, les politiques protectionnistes feront des gagnants. Ces derniers sont, en général, peu nombreux par rapport à l’ensemble de la société, arrivent à s’organiser et à se faire entendre facilement, qu’il s’agisse des syndicats ou des producteurs nationaux. C’est pourquoi des tarifs ont toujours existé et redeviennent à la mode.
Le libre-échange international est plus compliqué à défendre car il nécessite de prendre en compte l’intérêt général des consommateurs. Dispersés, ils profitent de pouvoir accéder à des biens et services produits ailleurs, mais ils ne sont pas à même de défendre directement leurs intérêts facilement. C’est l’un des atouts de l’Europe que d’être une zone relativement ouverte au commerce international, même si la France se distingue à ce sujet en s’opposant régulièrement aux accords de libre-échange au nom d’intérêts particuliers comme ceux des agriculteurs.
Mais dans ce domaine, le libre-échange est souvent un mauvais bouc émissaire. Les agriculteurs sont nombreux à profiter du commerce international et souffrent, avant tout, de nos travers nationaux, réglementaires ou fiscaux. Les agriculteurs français supportent, par exemple, 35 % des impôts sur la production agricole de l’Union européenne, soit un prorata deux fois supérieur à la part du marché de l’agriculture française (18 %). L’opposition française au Mercosur ne desserrera pas leurs contraintes, et détériorera la situation globale pour le consommateur.
Dans la situation actuelle, la meilleure stratégie en Europe est de se focaliser sur la résolution des problèmes nationaux (compétitivité, vieillissement, etc.), tout en complétant de manière habile et rapide le réseau d’accords de libre-échange avec le Mercosur et les pays d’Asie, afin d’offrir de nouveaux débouchés aux producteurs qui risquent d’être fortement impactés par les tarifs américains. Se réformer et commercer avec le reste du monde reste la meilleure parade.